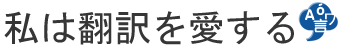- テキスト
- 歴史
Les liens créés vont petit à petit
Les liens créés vont petit à petit permettre de tisser une solidarité de voisinage. Ils donnent du sens à l’initiative collective, donnent une raison d’être (et non d’avoir), donnent confiance. L’habitat participatif a cela de particulier, qu’il privilégie le service à l’usager et non le profit. Il n’accorde pas sa priorité aux services marchands mais aux services relationnels gratuits. En cela déjà, il est utile à la société.
En Suisse, où le modèle coopératif est très développé, l’entraide et la solidarité perdurent dans le temps et se diffusent dans tout le quartier. (cf. exemple ci-contre)
UNE DIMENSION SOCIALE DOUBLE ENTRE OUVERTURE ET MIXITÉ
La signature sociale des groupes d’habitat participatif peut se définir par deux critères distincts : le contenu social et la diversité sociale du projet 05
• Un projet d’habitat participatif peut cibler un public fragile, à faibles revenus ou requérant une insertion sociale.
Des bailleurs sociaux peuvent faire participer un groupe d’habitants dès les premières étapes de programmation pour des projets d’accession sociale à la propriété ou de locatif social. Les coopératives d’habitants, montage mixte en propriété collective, proposent des logements coopératifs et solidaires à un public modeste qui bénéficie des aides du logement social.
Le Village Vertical à Villeurbanne préfigure cette solution. (cf. exemple ci-après)
• L’habitat participatif peut aussi favoriser une mixité sociale au sein même de son collectif.
Le groupe associe des personnes issues de classes sociales différentes, d’origines ou d’âges différents, ayant des handicaps ou non. Ces habitants ont pour beaucoup une acceptation sociale de cette mixité et cette acceptation peut diffuser dans l’îlot et dans le quartier et favoriser ainsi une meilleure intégration.
Le retour d’expérience québécois montre que l’insertion des personnes handicapées, âgées, immigrées est facilitée dans les coopératives d’habitations. (cf. exemple ci-contre).
Puisque les groupes ont la volonté de développer des mixités sociales, ces montages innovants peuvent contribuer à la diversité urbaine à l’échelle du quartier.
En Italie, ce sont les coopératives d’autorecupero qui créent une certaine mixité au coeur des grandes villes. (cf. exemple ci-après)
UNE DIMENSION GÉNÉRATIONNELLE
QUI RÉPOND AU DÉSIR DE MAINTIEN À DOMICILE
L’augmentation du nombre de personnes âgées pose de nouveaux défis en matière de politiques de santé et de logement mais également de cohésion sociale. Les personnes âgées ressentent plus fortement la solitude et l’insécurité. Elles souhaitent pouvoir maintenir des liens sociaux riches (la famille ne pouvant généralement pas couvrir tous ces besoins) et une vie sociale active dans un environnement adéquat.
En Suisse, où le modèle coopératif est très développé, l’entraide et la solidarité perdurent dans le temps et se diffusent dans tout le quartier. (cf. exemple ci-contre)
UNE DIMENSION SOCIALE DOUBLE ENTRE OUVERTURE ET MIXITÉ
La signature sociale des groupes d’habitat participatif peut se définir par deux critères distincts : le contenu social et la diversité sociale du projet 05
• Un projet d’habitat participatif peut cibler un public fragile, à faibles revenus ou requérant une insertion sociale.
Des bailleurs sociaux peuvent faire participer un groupe d’habitants dès les premières étapes de programmation pour des projets d’accession sociale à la propriété ou de locatif social. Les coopératives d’habitants, montage mixte en propriété collective, proposent des logements coopératifs et solidaires à un public modeste qui bénéficie des aides du logement social.
Le Village Vertical à Villeurbanne préfigure cette solution. (cf. exemple ci-après)
• L’habitat participatif peut aussi favoriser une mixité sociale au sein même de son collectif.
Le groupe associe des personnes issues de classes sociales différentes, d’origines ou d’âges différents, ayant des handicaps ou non. Ces habitants ont pour beaucoup une acceptation sociale de cette mixité et cette acceptation peut diffuser dans l’îlot et dans le quartier et favoriser ainsi une meilleure intégration.
Le retour d’expérience québécois montre que l’insertion des personnes handicapées, âgées, immigrées est facilitée dans les coopératives d’habitations. (cf. exemple ci-contre).
Puisque les groupes ont la volonté de développer des mixités sociales, ces montages innovants peuvent contribuer à la diversité urbaine à l’échelle du quartier.
En Italie, ce sont les coopératives d’autorecupero qui créent une certaine mixité au coeur des grandes villes. (cf. exemple ci-après)
UNE DIMENSION GÉNÉRATIONNELLE
QUI RÉPOND AU DÉSIR DE MAINTIEN À DOMICILE
L’augmentation du nombre de personnes âgées pose de nouveaux défis en matière de politiques de santé et de logement mais également de cohésion sociale. Les personnes âgées ressentent plus fortement la solitude et l’insécurité. Elles souhaitent pouvoir maintenir des liens sociaux riches (la famille ne pouvant généralement pas couvrir tous ces besoins) et une vie sociale active dans un environnement adéquat.
0/5000
リンクを作成するは、徐々 に近隣の連帯を構築します。彼らは集合的なイニシアチブに意味を与える、根拠を提供 (とは)、自信を与えます。参加型の生息地は特定、それを支持するユーザーと非営利サービスです。それはサービスがリレーショナルの無料サービスを市場に優先順位を与えない。すでに、この社会に有用です。スイス連邦共和国、協調モデルは非常に開発され、相互扶助と連帯で長期間にわたるし、地域全体に 。(以下の例を参照)ダブル開くと混合の社会的側面2 つの別々 の基準によって、参加型の生息地のグループの承認の署名を定義する: 下書きの 05 の社会的な内容や社会的多様性• 参加型生息地プロジェクト壊れやすい公共、低所得層をターゲットにできますまたは社会的な介在を必要とします。社会的な地主はプロパティまたはレンタル社会への加盟に社会のプロジェクトのためのプログラミングの初期段階からの居住者のグループを含むことができます。住民は、集合的な特性の協同組合の共同アセンブリ社会的なハウジングの援助を楽しんでいる控えめな視聴者に協調と協力的なハウジングを提供します。ヴィルールバンヌで垂直村 prefigures このソリューション。(以下の例を参照)• 参加型生息地もその集団の内で社会的なミックスを昇格できます。グループを組み合わせた、背景または年齢別の異なる社会のクラスからの人々 障害かどうか。これらの住民は多くのこの多様性の社会的な受諾およびこの受諾することができます普及島と近隣とのより良い統合を促進し。ケベック州の経験のフィードバック、障害を持つ人々 の挿入を示す高齢者、移民は促進される住宅協同組合。(以下の例を参照)。以来、グループは社会的な mixités を開発したい、これらの革新的な据え付け品は、地区全体で都市の多様性に貢献できます。イタリアでは、彼らは autorecupero の協同組合の主要都市の中心である特定のミックスを作成します。(以下の例を参照)世代別のディメンション在宅介護の欲望を満たす高齢者数の増加によって、保健・住宅だけでなく社会的な結束の新たな課題。高齢者はより強く孤独と不安を感じる。彼らは豊富な社会的なつながり (家族通常できませんすべてこれらのニーズをカバー) と適切な環境でアクティブな社会生活を維持することができるようにします。
翻訳されて、しばらくお待ちください..


作成したリンクは、徐々に近所の連帯を構築することができます。彼らは(持っていない)根拠を与え、集団イニシアチブに意味を与え、自信を与えます。参加生息地は、ユーザではなく、利益へのサービスに有利に働くことが、この特異性を有しています。これは、その市場サービスではなく自由リレーショナルサービスに優先権を与えるものではありません。すでにこのでは、社会に有用である。
協調モデルは非常に開発されたスイスでは、相互扶助と連帯は、時間の経過とともに持続し、周辺全体に広がります。(短所以下の例を参照してください)
DOUBLEオープニングと多様性間の社会的DIMENSIONを
参加型社会住宅群の署名は、2つの別々の基準で定義することができます。プロジェクトの社会的な内容や社会の多様性を05
•参加型住宅プロジェクト壊れやすい公共、低所得や社会参加を必要とするには、ターゲットにすることができます。
社会地主が所有権や社会住宅への社会事業の加入のために第1のプログラミング段階から住民のグループを含むことができます。住宅協同組合は、共同集団的性質、コーポラティブ住宅をマウントし、社会住宅の支援を楽しんでささやかな視聴者に連帯を提供しています。
垂直ビレッジヴィルーバンヌは、このソリューションを予示。(以下の例を参照してください)
参加生息地は、そのグループ内の社会的多様性を促進することができます•。
グループは、異なる社会階級の人々を結集背景や障害を持つ異なる年齢のかいいえ。これらの住民はブロックにし、周辺に拡散し、したがって、より良い統合を促進することができ、この多様性と受容の多くの社会的受容のために持っている。
ケベックの経験の復帰が無効になって、高齢者、移民の統合があることを示しています住宅協同組合に促進しました。。(短所以下の例を参照)
のグループは、社会的交絡を開発する意志を持っているので、これらの革新的な構成は、地区全体の都市の多様性に貢献することができます。
イタリアでは、これらはAUTORECUPEROを作成する協同組合です主要都市の中心部にある特定のミックス。(以下の例を参照してください)
世代DIMENSION
維持するために、ホームDESIRE ATミーツ
高齢者数の増加は、健康と住宅政策への新たな課題だけでなく、社会的一体性を提起します。高齢者がより強く孤独と不安を感じています。彼らは、適切な環境の豊富な社会的関係(家族は通常、これらのすべてのニーズをカバーすることはできません)、アクティブな社会生活を維持したいです。
協調モデルは非常に開発されたスイスでは、相互扶助と連帯は、時間の経過とともに持続し、周辺全体に広がります。(短所以下の例を参照してください)
DOUBLEオープニングと多様性間の社会的DIMENSIONを
参加型社会住宅群の署名は、2つの別々の基準で定義することができます。プロジェクトの社会的な内容や社会の多様性を05
•参加型住宅プロジェクト壊れやすい公共、低所得や社会参加を必要とするには、ターゲットにすることができます。
社会地主が所有権や社会住宅への社会事業の加入のために第1のプログラミング段階から住民のグループを含むことができます。住宅協同組合は、共同集団的性質、コーポラティブ住宅をマウントし、社会住宅の支援を楽しんでささやかな視聴者に連帯を提供しています。
垂直ビレッジヴィルーバンヌは、このソリューションを予示。(以下の例を参照してください)
参加生息地は、そのグループ内の社会的多様性を促進することができます•。
グループは、異なる社会階級の人々を結集背景や障害を持つ異なる年齢のかいいえ。これらの住民はブロックにし、周辺に拡散し、したがって、より良い統合を促進することができ、この多様性と受容の多くの社会的受容のために持っている。
ケベックの経験の復帰が無効になって、高齢者、移民の統合があることを示しています住宅協同組合に促進しました。。(短所以下の例を参照)
のグループは、社会的交絡を開発する意志を持っているので、これらの革新的な構成は、地区全体の都市の多様性に貢献することができます。
イタリアでは、これらはAUTORECUPEROを作成する協同組合です主要都市の中心部にある特定のミックス。(以下の例を参照してください)
世代DIMENSION
維持するために、ホームDESIRE ATミーツ
高齢者数の増加は、健康と住宅政策への新たな課題だけでなく、社会的一体性を提起します。高齢者がより強く孤独と不安を感じています。彼らは、適切な環境の豊富な社会的関係(家族は通常、これらのすべてのニーズをカバーすることはできません)、アクティブな社会生活を維持したいです。
翻訳されて、しばらくお待ちください..


は、作成されたリンクは、近所の連帯を構築を徐々にできるようにします。 彼らは、集団の主導権を意味し、(をませんでした)、自信を与えるのには理由があるをを与えます。 生息地の議題は参加型では、この特定の、彼のサービスを利用すると、ユーザーは、利益ではありませんを支持しています。 市場サービスに優先順位を付けます。ただし、リレーショナルサービスは解放されません。これはすでに、これは社会に役立ちます。
は、近所中のスイスでは、協同組合のモデルは非常に開発された、相互支援と連帯の持続時間とスプレッドになっています。 ( cf. 以下の例を参照してください )
は社会的な寸法をダブルとの間の開口部と MIXITÉ
は、生息地の住民参加型の社会的グループの署名は、 2 つの明確な基準によって定義することができます。社会的には、プロジェクトの 05
」に生息地プロジェクト参加型低所得層や社会参加申込者に公開壊れやすいターゲットできるのはコンテンツと社会的な多様性があります。
は、社会的な貸方はプロパティを社会の即位のまたはのための社会的 , レンタカー , プロジェクトのプログラミングの第 1 段階の住民のグループが含まれる場合があります。 共同の住民協同組合員集団所有権の社会住宅の援助を受けた糊口をしのが公共を混在して編集、提供住宅組合と連帯しています。
ヴィルールバンヌには、垂直方向の村はこのソリューションをご紹介します。 (参考)
「参加型の生息地は、その集団の同じ内の社会的なミックスの促進にもあります。以下の例。
社会的なクラスの人たちのグループに関連付けられた別の、起源、または異なる年齢、障がいやではありません。 これらの多くの住民は、この男女共学の社会的受容とこの受け入れのために、島との近隣で広めるかもしれないので、そのためのより良い統合を促進します。
の経験は、 quebecois 戻る障害を持つ人々が含まれたことで、高齢者、移民は、ハウジングの協同組合の促進であることを示します。 ( cf. 以下の例を参照してください ) 。
グループの社会的 mixites がして以来、革新的なこれらのマウントは ' 地域レベルでは、都市の多様性に貢献することができます。
イタリアでは、これは、 co の autorecupero の主要都市の中心部にある、特定の混合を作成します。協同組合 ( cf. 以下の例を参照してください )
DÉSIR ホームメンテナンスに対応する寸法 GÉNÉRATIONNELLE
の高齢者数の増加は健康と住宅のポリシーのフィールドに新しい課題をもたらし、社会的結束にもしています。高齢者の感じをより強く、孤独と不安。 彼らは、適切な環境でリッチ(これらのすべてには通常はできませんカバーする必要があり、ご家族)と、積極的な社会生活の社会的関係を維持できるようにしたいです。
は、近所中のスイスでは、協同組合のモデルは非常に開発された、相互支援と連帯の持続時間とスプレッドになっています。 ( cf. 以下の例を参照してください )
は社会的な寸法をダブルとの間の開口部と MIXITÉ
は、生息地の住民参加型の社会的グループの署名は、 2 つの明確な基準によって定義することができます。社会的には、プロジェクトの 05
」に生息地プロジェクト参加型低所得層や社会参加申込者に公開壊れやすいターゲットできるのはコンテンツと社会的な多様性があります。
は、社会的な貸方はプロパティを社会の即位のまたはのための社会的 , レンタカー , プロジェクトのプログラミングの第 1 段階の住民のグループが含まれる場合があります。 共同の住民協同組合員集団所有権の社会住宅の援助を受けた糊口をしのが公共を混在して編集、提供住宅組合と連帯しています。
ヴィルールバンヌには、垂直方向の村はこのソリューションをご紹介します。 (参考)
「参加型の生息地は、その集団の同じ内の社会的なミックスの促進にもあります。以下の例。
社会的なクラスの人たちのグループに関連付けられた別の、起源、または異なる年齢、障がいやではありません。 これらの多くの住民は、この男女共学の社会的受容とこの受け入れのために、島との近隣で広めるかもしれないので、そのためのより良い統合を促進します。
の経験は、 quebecois 戻る障害を持つ人々が含まれたことで、高齢者、移民は、ハウジングの協同組合の促進であることを示します。 ( cf. 以下の例を参照してください ) 。
グループの社会的 mixites がして以来、革新的なこれらのマウントは ' 地域レベルでは、都市の多様性に貢献することができます。
イタリアでは、これは、 co の autorecupero の主要都市の中心部にある、特定の混合を作成します。協同組合 ( cf. 以下の例を参照してください )
DÉSIR ホームメンテナンスに対応する寸法 GÉNÉRATIONNELLE
の高齢者数の増加は健康と住宅のポリシーのフィールドに新しい課題をもたらし、社会的結束にもしています。高齢者の感じをより強く、孤独と不安。 彼らは、適切な環境でリッチ(これらのすべてには通常はできませんカバーする必要があり、ご家族)と、積極的な社会生活の社会的関係を維持できるようにしたいです。
翻訳されて、しばらくお待ちください..


他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.