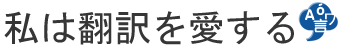- テキスト
- 歴史
Dans la salle commune du départemen
Dans la salle commune du département d’agriculture de Hokkaido Daigaku : une grande étagère en bois brut remplie de mangas poussiéreux, une table basse récupérée dans un vide-grenier, un étrange bocal d’alcool fort dans lequel marinent des noisettes, une vieille affiche écornée représentant une chaîne de montagnes enneigées et un gros fauteuil de cuir défoncé. Je suis assis dans le fauteuil, un thé aux fruits dans les mains, et j’interviewe des élèves dans le cadre d’un devoir d’anthropologie.
– Pourquoi est-ce que tu étudies l’agriculture ?
SAYAKO KANIE – alias « Le Crabe », petite aux yeux ronds, 22 ans
C’est une longue histoire. J’ai commencé par faire de la génétique dans une autre fac. Comment est-ce que l’oxydation fait vieillir la peau, l’ADN, tous ces trucs de micro-biologie. Après un passage à l’institut scientifique de Nara, je suis partie au Cambodge quelques mois. Un vrai choc : les décharges au milieu des rizières, les écoles en torchis sans eau courante… J’ai réalisé que tout était lié à l’environnement, que l’éducation environnementale était une priorité. A la fin de mes études en biologie, j’étais censée commencer à chercher un travail, mais au lieu de ça je me suis inscrite au collège d’agriculture de Hokudai. Idéalement, je voudrais travailler en tant que conservateur dans un musée scientifique… mais c’est probablement impossible de gagner de l’argent avec ça !
Le problème de l’agriculture au Japon est d’abord un problème d’image. Pour le japonais moyen, un fermier c’est quelqu’un qui fait un « 3K job » : « Kitanai », « Kiken », « Kitsui » – c’est-à-dire « boueux », « risqué » et « pénible ». Les enfants d’agriculteurs savent à quoi s’attendre et beaucoup d’entre eux fuient cette mauvaise réputation. Résultat : le nombre de terres exploitées à Hokkaido se réduit d’année en année alors qu’il y a énormément de choses à développer ici.
– Qu’est-ce que tu veux faire après Hokudai ?
AKARI HOSHINO – leader du club d’agriculture, grande musclée, 21 ans
Probablement fonctionnaire spécialiste des questions d’agriculture, comme mon père. Quand j’étais enfant, on allait souvent chez mes grands-parents, qui habitent une maison dans la campagne du nord de Niigata. Mon grand-père exploitait plusieurs rizières dans la région. Quand ma mère était débordée, ma grand-mère descendait en ville, louait une petite parcelle de terre et cultivait des légumes pour tout le monde ! Je pense que ma vocation vient de là. A l’université j’ai fait beaucoup d’économie : comprendre comment fonctionne le cours des denrées alimentaires, comment combattre la pauvreté. Donc évidemment, je veux contribuer à améliorer la qualité de vie des agriculteurs.
L’agriculture est intrinsèquement liée à la vie humaine, ça ne concerne pas que les campagnards ! Tous mes potes de lycée veulent devenir agriculteurs, mais c’est vrai qu’ils viennent pour la plupart de zones rurales… Pourquoi est-ce que les gens des villes ne veulent pas devenir fermiers ? Parce qu’ils n’ont pas de champs ! Pour faire ce boulot, il faut avoir un capital – qui vient en général de tes parents. Pourtant, l’agriculture est l’un des seuls domaines de l’économie qui n’a pas de limites, dans le sens qu’elle peut être durable. Le futur est dans les champs !
– Quel est ton rapport à la nourriture ?
KYOKO ITO – née à Tokyo, cheveux courts et visage rond, 19 ans
Quand j’étais écolière, mes parents avaient un grand jardin et je mangeais des fruits frais tous les jours, j’imagine que ma passion pour la cuisine vient de là. Mon rêve a toujours été d’apporter la meilleure nourriture possible à tout le monde. Par exemple, j’adorerais aller en Afrique pour apprendre comment cultiver des plantes sur un sol aride. L’agriculture est pleine de promesses, de nouvelles techniques sont découvertes tous les jours. J’imagine aussi que mes parents m’ont aussi beaucoup influencée. Mon père travaille comme ingénieur chez une grande marque de bière et ma mère fait des recherches en diététique à l’université.
Notre besoin de nourriture nous force à de plus en plus d’innovation mais, en parallèle, la pression du changement climatique et des marchés financiers a rendu la pratique de l’agriculture encore plus difficile. Nous ne devrions pas être trop arrogants vis-à-vis de la nature mais au contraire encourager l’imagination. L’agriculture est un débat constant, il n’y a pas de modèle unique. Si un jour je vais en Afrique, je me forcerai à ne pas être trop japonaise dans mes pratiques, à m’ouvrir à d’autres techniques. Comprendre les autres méthodes de culture est un moyen de s’ouvrir à l’autre.
– Est-ce que tu te sens proche de la nature ?
MARINE ASHIZAWA – souvent à la bibliothèque, regard rêveur, 21 ans
J’aime la nature. Enfant, je détestais rester à la maison, il fallait absolument que je sorte au grand air ! Je crois fermement que la culture de la terre n’est pas une activité anodine, elle est inscrite dans notre nature humaine. Quand je cultive un champ, je me sens plus re
0/5000
北海道大学農学部共通の部屋で: 挨りだらけ漫画、ヴィデ グルニエ、強いアルコールの奇妙な壷漬けヘーゼル ナッツ、雪に覆われた山々 と大規模な革の範囲を表す、変色、古いポスターに回復したコーヒー テーブルで満たされた素晴らしい raw 木製棚椅子を壊した。私は手では、フルーツとお茶、椅子に座っていると人類の義務の一部として学生をインタビューします。-なぜ農業を勉強しているのですか。紗也子蟹江 - 別名「カニ」、小さな丸い目、22 年長い話です。私は別のカフェで遺伝学を始めた。どのように酸化老化皮膚、DNA、微生物学のすべてのこのようなもの。スティントの後、奈良の科学研究所で、私はカンボジアに部分的な数ヶ月。本当のショック: 水を実行せず泥の学校田んぼの真ん中にダンプ.私は、すべてが環境にリンクされていたこと、環境教育が優先されたことを実現しました。生物学における私の研究の終わりに、私は北大の農業の大学に入学するがの代わりに仕事のための検索を開始するはずだった。理想的には、... 科学博物館の学芸員として仕事したいと思いますが、金を稼ぐにはおそらく不可能だ!日本の農業の問題は、イメージの問題を最初です。平均的日本人の農家は「3 K 仕事」にいる誰か:「Kitanai»、«棄権»、«ーキツイ」すなわち「泥」、「危険」と「痛み」.農家の子どもたちは、何を期待する知っている、それらの多くはこの悪評を逃げています。結果: 北海道の大地の数が減少前年同期から、ここに開発することがたくさん。-どのような北大後はしたいですか。星野あかり - 農業、大きい筋肉 21 年クラブのリーダー私の父のような農業問題のおそらく専門家役員。子供の頃よく新潟県北部の田舎の家に住んでいる祖父母に行きました。私の祖父は、地域のいくつかの田んぼを運営しています。私の母は、圧倒されました、町の下の私の祖母は、土地の小さなプロットを借りたし、誰にとっても野菜を育てた!私の職業は、そこから来ていると思います。大学で経済学の多くをやった: 理解どのように食品、もちろん貧困と闘うための方法。これは明らかに、農民の生活の質を向上させることにします農業は本質的に人間にリンクされている生活、国の人々 だけではありません!高校からのすべての私の仲間は、農家になりたいが、それは事実、彼らは主に農村部から来る.なぜ、都市からの人々 は農民はなるまいか。フィールドはない!この仕事を行う、あなたの両親に由来する、資本金を持っています。しかし、農業は、持続可能なすることができます意味で制限がない経済の領域のみです。将来は、分野で!食品の関係とは?伊藤京子 - 生まれ東京、短い髪、丸顔、19 歳女子高生だった、私の両親は大きな庭を持っていたし、私は毎日新鮮なフルーツを食べた、調理のための私の情熱は、そこから来ていると思います。私の夢は、すべての人に最良の食品を提供するために常にされて。たとえばは不毛の地の植物を栽培する方法を学ぶにアフリカに行きたいです。農業は将来性に満ちた、新しい技術が毎日を発見しました。また、多くが影響すると私も私の両親を想像します。私の父は、大規模なブランドのビールと私の母、大学で栄養学の研究を作ったエンジニアとして勤務。食品の我々 が必要私たちのさらなる技術革新に力しますが、並行して、気候変動や金融市場からの圧力をした農業の実践さらに困難。我々 は自然に向かってあまりにも傲慢ではないが、逆に想像力を奨励する必要があります。農業は一定の議論、1 つのモデルはありません。1 日私はアフリカに行く場合も私のプラクティスは、他の技術に開いて私の日本語はできません無理やり。文化の他の方法は他に開放する方法を理解します。-あなたは自然に近い感じですか。図書館、夢のような外観、21 歳でしばしば - 海洋の芦澤自然が大好きです。子供嫌いが家に絶対に必要だった、私は屋外の種類!しっかりと地球の文化は、無害な活動ではない、我々 人間の本性に在籍と思います。耕そうより日時を感じます
翻訳されて、しばらくお待ちください..


北海道Daigakuの農業部門の共通の部屋で:ガレージセールで回収されたほこりっぽい漫画原木のコーヒーテーブルで満たされ、大きな棚、奇妙なハードリカージャーは、古いポスターでヘーゼルナッツをマリネ雪山のチェーンと強打大きな革張りの椅子を表す凹みます。私は、椅子に手にフルーツティーを座って、私は人類の義務の一環として学生にインタビュー。- なぜあなたは、農業を勉強しますか?小夜子蟹江-別名" カニは「小さな丸い目は、22それは長い話です。私は別の大学で遺伝学を始めました。どのように酸化老化した皮膚、DNA、これらのすべてのマイクロ生物学のものということです。奈良の科学研究所のスティントの後、私は数ヶ月カンボジアを残しました。実際の衝撃:流水のない田んぼ、学校の穂軸の真ん中にショック...私はすべてが環境に関連していたことに気づいたが、環境教育を優先しました。生物学における私の研究の終わりに、私は仕事を探し始めることになっていたが、それに代わって、私は農業北大の大学に在籍。理想的には私は科学博物館で学芸員として働きたい...しかし、それはそれでお金を稼ぐために、おそらく不可能だ!日本の農業の問題は、主に画像の問題です。平均的な日本人のために、農民は「3K仕事"を作る人です:「kitanai"、 "Kiken」、「キツイ」 -それは言うことですが、「泥だらけ" "危険な"と"痛いです"。農民の子どもたちが期待すると多くは悪い評判を逃れているか知っています。結果:ここで開発するために多くのものがありますが、北海道で使用する土地の数は年々減少している。- あなたは北大後はどのように過ごしたいですか?星野あかり-クラブ指導者の農業、大きな筋肉質、21私の父のようなおそらく農業問題の専門家役員、。私が子供だったとき、私たちはしばしば北新潟の田舎に家に住んでいる祖父母、一緒に行きました。私の祖父は、エリア内のいくつかの水田を運営しています。私の母は圧倒されたとき、私の祖母は、ダウン市内で、土地の小さなプロットを借りて、すべての人のための野菜の増加となりました!私は私の天職が来ると思います。大学では、私は、経済の多くをした:食糧価格は、どのように貧困と闘う方法を理解します。だから、明らかに、私は農民の生活の質を向上させる手助けをしたい。農業は人間の生活に本質的に関連している、それが懸念国の人々だけではしません!すべての私の高校の仲間は、ファームにしたいが、それは人々が都市が農民になることを望んでいないということですなぜそれが...彼らは農村部から主に来るというのは本当ですか?彼らはフィールドを持っていないので!通常、ご両親から来ている-この仕事を行うには、資本を必要とします。しかし、農業はそれが持続可能であることができるという意味では、何の制限もありません経済の唯一の地域の一つです。今後は、フィールドにある!- 食品との関係は何ですか?伊藤京子 - 19、短い髪と丸い顔、東京に生まれ、私は女子高生だったとき、私の両親は、大きな庭を持っていたし、すべての私は新鮮なフルーツを食べたが、日、私は、料理のための私の情熱はから来ていると思います。私の夢はいつもみんなのために可能な限り最高の食品を提供することでした。例えば、私は不毛の土地に植物を育てる方法を学ぶためにアフリカに行くのが大好き。農業は新しい技術が日々発見され、有望です。私も私の両親も私をたくさん影響を与えていることを想像してみてください。私の父はビールの主なブランドでエンジニアとして働き、私の母は大学で栄養学の研究をしました。私たちの必要性を、より多くの技術革新への食品軍たちをするために、しかし、並行して、気候変動の圧力と金融市場は、農業の実践がより困難になりました。私たちは向かい合っ自然あまりに傲慢ではないはずですが、想像力を奨励します。農業は単一のモデルが存在しない、一定の議論です。ある日、私はアフリカに行くんだ場合、私は他の技術を開くために、私の練習では、あまりにも日本人ではないと自分自身を強制します。他の培養方法を理解することは、相互に開放する方法です。- ?あなたは自然に近い感じますMARINE芦沢を- 多くの場合、ライブラリー、うっとりした表情、21歳の時、私は自然が大好きです。子供は、私が家に滞在嫌っ、私は偉大なアウトドアをソートするために持っていました!私はしっかりとそれが私たちの人間性に内接する、土地の文化が些細な活動はないと信じています。私はフィールドを開拓するとき、私はより多くの再を感じます
翻訳されて、しばらくお待ちください..


他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
- アラビア語を学ぶことは楽しい
- tokkol nga
- さっきも話した通りだけど僕じゃ駄目って思っていいんですね
- tokkol
- OMG !!!!!! Can I come with you next year
- Voornaam
- 彼は男の子です。彼は家族と散歩に行きました。彼は迷子になりました。彼は家族を探し
- Please buy a premium membership for unli
- 私はインドに行きたいです
- Woonplaats
- Bakrt may gusto ka sakin
- Stad
- 空の空
- あなたを選んだのはさっきも話した通り
- 1 billion yen
- ana met ata tol
- インドの文化
- Bedrijfsnaam
- 胸ちら
- tol
- 日本語
- Bakit may gusto ka sakin
- Bka tokkol
- praten naast